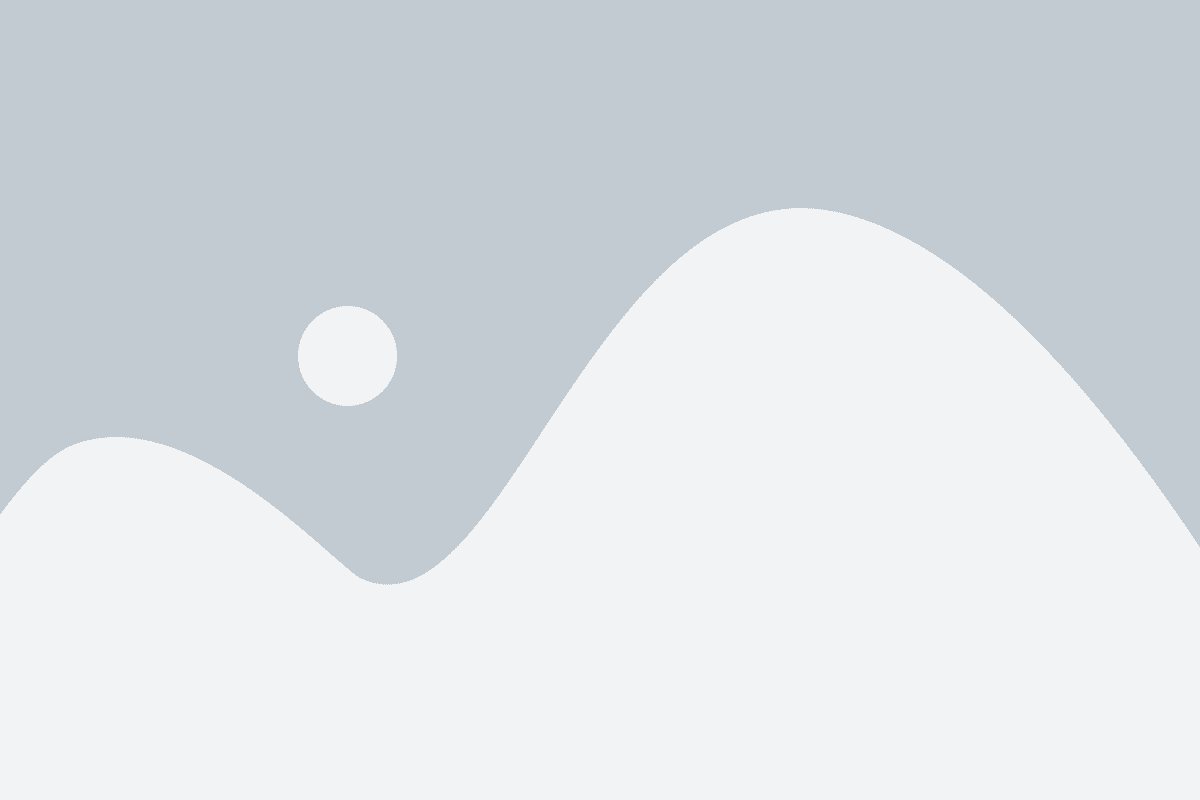Introduction: pourquoi des réflexions sur le pouvoir?
Janvier 2013 : mon chef m’appelle dans son bureau – les nouvelles ne sont pas bonnes. Sans vraiment me donner d’explications, il me retire le poste auquel il m’avait promu neuf mois auparavant et m’en donne un autre que certains auraient qualifié de voie de garage, certes transformée en rampe de lancement pour mon activité actuelle, mais c’est une autre histoire.
Le choc passé, quelques éléments explicatifs sont apparus. Tout d’abord, né dans une famille modeste, de parents fils de régisseur et fille de veuve, le pouvoir était systématiquement associé au Mal, aux Grands, aux Autres ; le pouvoir était donc une Mauvaise Chose et il fallait s’en éloigner le plus vigoureusement possible. Machiavel était, comme pour beaucoup, le hérault du Mal incarné et le héros des Mauvaises Gens.
Ensuite, dans les entreprises dans lesquelles j’ai travaillé jusqu’à ce choc fatal à ma carrière, j’ai toujours été protégé des arcanes de la politique managériale par mon responsable. Ce n’est que lors de ma promotion en mai 2012 que je suis entré dans cette arène – je prends cette métaphore à dessein – et que j’en suis ressorti les pieds devant. « Ave Caesar, morituri te salutant » aurait pu s’appliquer à moi tant je n’étais pas préparé à ce qui s’y jouait. A mon entrée dans cet amphithéâtre de la politique organisationnelle – continuons avec la métaphore gladiatoriale, je n’ai pas prêté attention aux jeux de pouvoir entre mes collègues et moi, entre eux, et surtout entre moi et mon responsable, membre de direction. Ces interactions étaient pour moi à prendre au premier degré, comme on me l’avait appris à la maison. La politique ne devait pas m’intéresser, elle ne m’intéresserait pas. Pourtant, quelque chose se jouait au seuil de ma conscience. Je voyais des regards, des gestes, des décisions qui m’échappaient, mais il me manquait un outil de compréhension pour y accéder.
C’est pendant ma formation en développement organisationnel que j’ai été rendu attentif à l’impact personnel du consultant en gestion du changement et aux conséquences de son comportement sur le système dans lequel il évolue – une évidence dans une approche systémique des organisations mais une nouveauté complète pour moi. J’avais vécu jusqu’alors dans un monde dans lequel seul le logos existait, dictateur du discours qui ne laisse une place ni à l’ethos ni au pathos. La rationalité cartésienne, dangereuse tentation en matière de relations humaines, m’avait séduit comme elle l’avait fait pour des millions d’homo rationalis avant moi. D’ailleurs, la plupart des théories économiques font encore l’hypothèse que l’humain fait des choix rationnels, malgré les travaux de Kahnemann et Tversky ou de Amartya Sen. Pour paraphraser Spinoza, « ni rire, ni pleurer, mais comprendre »: une fois l’émotion de l’échec passée, il était temps de commencer à analyser ce qui s’était passé en commençant par une question fondamentale pour moi : qu’est-ce que le pouvoir ?
Définition du pouvoir
Le pouvoir est la capacité latente croisée d’entités à influer dans le temps sur leurs choix respectifs, proportionnelle à la qualité des relations entre ces entités dans une situation donnée. Cette définition, construite au travers de réflexions lexicales et d’une proposition de modèle, permet une démystification et une opérationnalisation de la notion de pouvoir qui rendent ses mécanismes de constitution disponibles à toutes les personnes ouvertes à dépasser des préjugés ancrés dans une définition classique du pouvoir uniquement vu comme un rapport de forces entre dominant et dominé
- Capacité latente: potentiel
- Entité => individus et organisations
- Influer dans le temps sur les choix des autres
- Démystification: le pouvoir n’est pas magique
- Opérationnalisation: développer des relations de qualité
- Préjugés ancrés dans le pouvoir comme rapport de force (plutôt que comme rapport)
Conclusion: le pouvoir pour tous
La définition du pouvoir que je propose ainsi que son application dans le cadre des organisations est résolument sociologique et néglige complètement les aspects psychologiques en jeu. La personne comme sujet, et donc comme objet philosophique, est une idée récente que certains attribuent à Descartes dans son Discours de la méthode et d’autres à Montaigne dans ses Essais. Peu importe : cette percée conceptuelle, dans un monde précédemment organisé en grandes structures symboliques et impersonnelles (Dieu, le Roi, le Père, la Nation, l’Histoire), a introduit la nécessité d’un équilibre, ou tout du moins d’un chemin, entre ces idées et une nouvelle réalité individuelle.
Le Mariage était une institution symbolique chargée de cimenter la famille comme unité économique fondamentale de la société qui ne prenait pas en compte les aspirations individuelles ; bon nombre de récits tout aussi symboliques racontent d’ailleurs la lutte des individus contre la dictature de la tradition. Aujourd’hui, il n’est pas rare de rencontrer des personnes qui viennent de célébrer leur troisième mariage – minuscule donc : la nécessité d’une stabilité sociale ou économique cède devant l’individu. Le Journal était une institution qui permettait à une communauté d’avoir les mêmes faits à débattre ; si ceux-ci ne donnaient pas forcément une représentation fidèle de la réalité, celle-ci, bien qu’imparfaite, avait au moins le mérite d’exister. Aujourd’hui, les fils d’actualité, les éléments présentés par les réseaux sociaux et les contenus proposés par les plateformes de streaming sont personnalisés : la réalité de l’un.e est déconnectée de la réalité de l’autre. La Description de poste correspondant à un emploi salarié était une institution chargée de rassembler administrativement des personnes différentes pour le bien de l’organisation qui les employait : mêmes exigences, mêmes compétences, même salaire. Aujourd’hui, certaines firmes passent à la description de poste individualisée pour mieux prendre en compte les besoins et aspirations des employé.e.s.
Je ne suis ni conservateur ni réactionnaire. Ces trois exemples montrent simplement la difficulté de considérer l’individu au-delà de son existence comme élément d’un système plus vaste que lui. Le problème de l’individualisme en tant que paradigme explicatif du pouvoir est, comme j’espère l’avoir montré, qu’il ne permet pas de rendre compte des situations réelles vécues par les personnes et les organisations ; pire, il rend l’exercice du pouvoir l’apanage exclusif d’une élite.
Ce qui est paradoxal, c’est que cette capacité latente à se mettre en état d’activer des moyens d’agir, n’est-ce pas une manière un peu alambiquée de décrire une capacité fondamentale de tout être vivant, c’est-à-dire modifier son environnement pour assurer sa survie ? Cette force presque magique, difficile à saisir, qui nous pousse à établir des relations aux objets, aux individus, aux organisations, n’est-ce pas cette volonté vers la puissance que nous mentionnions au début de ce texte qui pourrait s’apparenter à cette capacité latente qui ne demande qu’à exister ? Le réseau de relations qui sert de support au pouvoir est un facteur de stabilité parce qu’il réduit l’incertitude essentielle de la vie, incertitude que nous devons accepter. Sans ce réseau, chaque interaction serait une nouvelle aventure consommatrice d’énergie – un système très mal optimisé. Finalement, si le pouvoir est partout, n’est-ce pas parce cette force est partout et disponible pour tous ?
Le paradoxe n’est peut-être qu’illusion : le fait est que l’humain vit en groupe. L’individu est une des entités qui vit dans l’espace des relations, mais il n’est pas le seul; d’autres sont présents, comme les familles ou les objets. Ainsi, la volonté vers la puissance, le potentiel d’activation, personnel et individuel, ne peut s’exprimer que dans un espace des relations qui dépend des entités présentes dans le système de l’individu. Le groupe contraint donc essentiellement l’individu, pas uniquement de manière phénoménologique ; le pouvoir est un phénomène de groupe même s’il est une capacité individuelle. Le pouvoir ne doit pas être vu comme une propriété ou un objet individuel. Le faire mène à la haine des gens de pouvoir et des politicien.ne.s, donc au désintérêt pour la chose publique. Le faire mène à une classe de personnes qui possèderaient un pouvoir par héritage, donc à la séparation de notre société en classes. Le faire mène à considérer l’aptitude humaine à la relation et au choix comme moins utile que celle qui consisterait à se soumettre au don transcendantal d’un objet magique.
Postface
Refuser, pour des questions de moralité personnelle finalement peu réfléchies, de reconnaître les jeux de pouvoir de l’organisation à laquelle j’appartenais m’a coûté mon dernier poste de cadre en entreprise. Onze ans plus tard, j’ai trouvé des pistes de réflexion pour comprendre ce qu’est le pouvoir, comment il est constitué, renforcé ou affaibli, libéré. Ce chemin parcouru me fait prendre conscience de l’importance de l’immanence comme paradigme potentiellement explicatif de mon comportement : ce qui est plutôt que ce qui devrait être. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup.
Si vous voulez lire le travail dans son intégralité, contactez-moi!