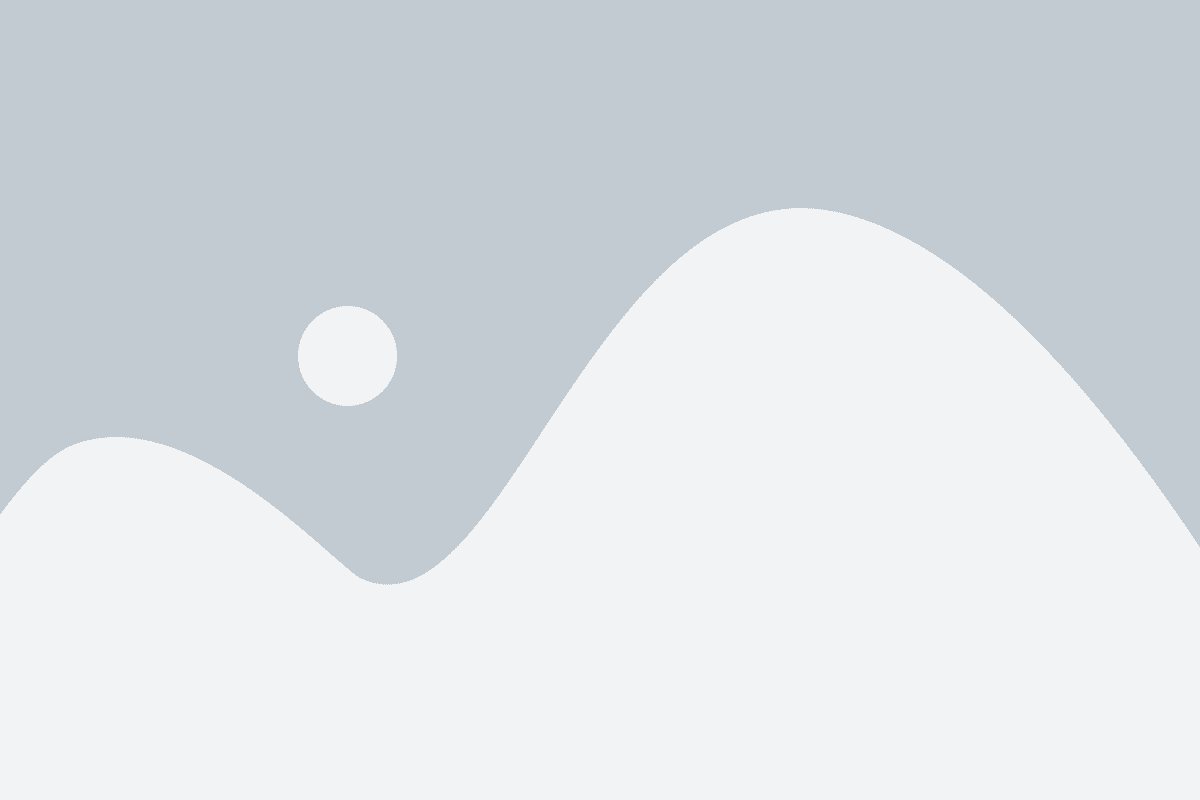Aujourd’hui, brain dump.
Je viens de lire un article sur LinkedIn à propos de leadership écrit par des gens très bien. Dans cet article, il est mentionné que le leadership est avant tout basé sur la capacité à structurer et à emmener: « Un leader se ressent surtout par son absence. Sans lui, l’équipe manque de direction et perd son cap. Le vrai leader sait donner du sens, structurer l’action et atteindre les objectifs communs« . Chez COAPTA, la capacité à structurer est appelée « management »; seule la capacité à emmener est appelée « leadership ». Passons.
Pour une raison que j’ignore, cet article m’a fait réagir et j’ai posté un commentaire, ce que je fais relativement peu souvent: « Un leader qui se rend donc indispensable? Est-ce vraiment la meilleure solution ? Je suis assez convaincu du contraire. Sinon, comment réconcilier ce leadership et le besoin naturel d’autonomie? Et est-ce que créer la dépendance pour de « bonnes » raisons n’est tout de même pas créer de l’inféodation? »
Ce qui m’a frappé dans cet article, c’est la dimension de la place au centre du leader. Cela m’a tout de suite fait penser à ces managers qui, en dessinant leur équipe, la dessinent en étoile avec eux au milieu, comme s’ils disaient: « il n’y a que la relation entre moi et les personnes avec qui je travaille qui compte », alors qu’en fait, dans la réalité, c’est bien différent: les relations entre les personnes en équipe comptent tout autant voire plus que les relations que le supérieur hiérarchique peut avoir avec chacun des membres de son équipe.
Et pourtant on continue à penser à un leader comment quelqu’un d’essentiel qu’on met au centre ou au-dessus (comme dans les organigrammes) – le leader qui sait n’est-il aussi pas celui qui n’apprend plus? Le leader qui partage la vision n’est-il pas aussi celui qui empêche les autres de rêver? Le leader qui décide n’est-il pas aussi celui qui impose? Le leader qui propose la direction n’est pas aussi celui qui empêche les autres d’en définir une pour eux-mêmes?
Il m’est revenu la phrase d’Etienne de la Boétie, écrite au 16e siècle alors qu’il n’a que 18 ans: « Soyez résolus de ne plus servir, et déjà vous voilà libres« . C’est un idéal de liberté difficile à atteindre, et, finalement, pourquoi ne s’appliquerait-il pas au monde des organisations ? La psychologie moderne nous enseigne que l’autonomie et le besoin d’être connecté sont les deux grands axes motivationnels au travail. Comment être autonome avec un chef qui nous impose sa vision, sa direction, ses objectifs, ses valeurs, son éthique et son exemplarité ? Comment, dans un contexte comme celui-là, devenir autonome, maître de ses choix et de ses décisions ? Comment faire les erreurs qui vont nous permettre d’apprendre ? Cela me paraît impossible.
Notez que La Boétie dit « Soyez résolus de ne plus servir », pas juste « Décidez de ne plus servir », ou « Imaginez », ou « Demandez », mais « Soyez résolus ». Cela veut dire que c’est difficile, cela veut dire que décider de ne plus servir ne suffit pas; nous allons être attaqués pour ce besoin de liberté (d’autonomie dans le monde professionnel). La Boétie nous donne cette phrase comme un antidote à la tyrannie. En avons-nous besoin?
Vous me direz qu’en entreprise, nous sommes dans une tyrannie, je viens d’ailleurs d’en discuter à midi avec un ami. Oui, dans beaucoup d’entreprises, c’est le cas, c’est une tyrannie. Mais cela n’est pas une fatalité. Le législateur n’indique pas que l’employé, signataire du contrat de prestation contre rémunération, doit renoncer à sa liberté. Il doit juste faire son travail avec diligence et loyauté (un autre mot chargé, celui-là). Peut-il réussir cette mission tout en conservant son autonomie? J’en suis convaincu.
Avant, la tyrannie se parait des atours du paternalisme: nous acceptons de nous soumettre, pas parce que nous avions signé un contrat de travail, mais parce que l’entrepreneur (masculin) était comme notre père, un peu dur, un peu vache, mais équitable ; il garantissait surtout notre sécurité, notre développement. Notons le retour à ce type de tyrannie sécuritaire dans bien des pays, ce qui est parfaitement logique au vu de la situation instable qui règne actuellement: les petits enfants ont peur du lendemain, refugions nous chez papa qui s’occupera de tout à notre place.
Aujourd’hui, c’est la tyrannie bienveillante qui a pris le pas. On sort de la vieille tyrannie paternaliste pour nous dire : acceptons la tyrannie de notre chef parce qu’il est bienveillant, parce qu’il nous veut du bien. Mais où est l’autonomie là-dedans ? Refuser la liberté, c’est facile: je ne décide pas, je me laisse mener. Cela ne coûte rien de savoir qu’on s’inféode à quelqu’un parce que on est quitte de réfléchir, ça ne coûte rien en énergie de se taire. Mais ça coûte cher en potentiel humain gaspillé.
Avons-nous vraiment besoin de leaders qui structurent et qui emmènent? Est-ce qu’en entreprise, le leadership doit à tout prix être cette capacité à diriger, à décider, à être devant, à tirer, à sermonner, à visionner, à présenter, à convaincre, à rayonner ? Un leader avec un sourire aux lèvres et une convention d’objectifs à la main? Un leader bien intentionné pour moutons serviles?
Je ne suis pas étonné que la génération Z refuse d’être promue dans des proportions bien plus grandes que celles des générations précédentes. Franchement, ça vous fait envie d’être un leader dans ces conditions?
A moi pas.