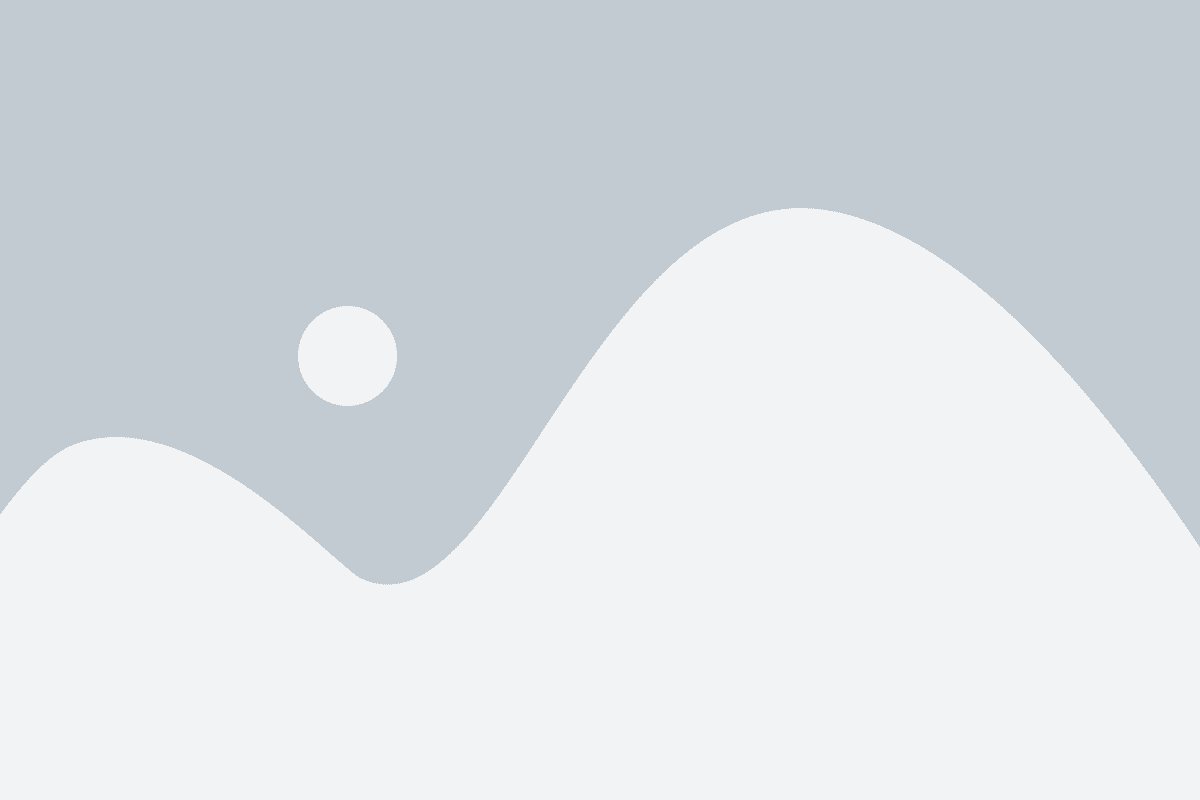Manager, ça se dit comment au féminin ?
Sommes-nous une manager ?Une manageure ? Un manager ? Plus qu’une question d’orthographe, je fais l’hypothèse que l’image sociale assignée à la femme impacte de manière décisive la façon dont elle est perçue et se perçoit dans ce rôle.
Je parle bien de rôle, c’est-à-dire de la manière dont on envisage personnellement sa façon de travailler et son implication dans son poste. Ce qui définit la fonction, c’est le cahier des charges, qui donne les règles du jeu et le périmètre de responsabilité qui lui correspond.

Qu’est-ce que le management au féminin ?
Réfléchissons ensemble à ce qui définit le concept de management au féminin.
Qu’est ce qui est attendu de la fonction de manager ? Qu’est ce qui la définit ? Cette définition est-elle impactée par le sexe de la personne qui occupe ce poste ?
Les compétences ?
Les attentes posées à la fonction de manager se résument à des compétences et des résultats. Les compétences, puisqu’elles sont le fruit de l’apprentissage, sont aujourd’hui accessibles à toutes et tous. L’exigence de résultats, elle aussi, ne voit pas le genre. Ainsi, si on ne prend en compte que la dimension des compétences, la question du management au féminin n’a pas de raison d’être.
Les qualités ?
Cherchons ailleurs la spécificité du management au féminin. Dans des qualités ? Peut-être, mais une qualité se définit par rapport à un référentiel, une norme, dont l’interprétation peut varier d’une personne à l’autre et dont le sens est individuel, dépendant de l’éducation, de la culture, de l’âge et de l’expérience.
La qualité est donc difficile à utiliser telle quelle, elle doit être contextualisée et être traduite en valeur organisationnelle, en processus, en procédure, puis déclinée en responsabilité et enfin en tâche pour être objectivable et surtout non interprétable. Pas simple et surtout terriblement normatif, réduisant la personne à une fonction sans pensée au moyen de ses qualités. Les qualités ne sont donc pas spécifiques ou constitutives d’un management au féminin puis que nous avons toutes et tous des qualités.
La personnalité ?
Une personnalité peut-être ? Dans une société heureusement multiculturelle, multigénérationnelle, multiple, tout simplement, la personnalité doit pouvoir s’exprimer pour faire la différence. C’est dans l’accueil de cette personnalité que s’expriment toutes les représentations sociales. Forte, gentil, efficace, douce, autant de qualificatifs qui amènent certes de la différenciation, mais aussi des malentendus, puisque ce sont des interprétations.
En effet, ces interprétations sont des constructions mentales induites par notre système de valeurs et de pensées. La personnalité n’est donc pas en elle-même une question de genre mais le devient en raison du contexte dans laquelle elle s’exprime.

Le champ social comme contexte
Il est défini par les représentations sociales au niveau sociétal et par les rôles sociaux au niveau des individus. Il s’exprime par des images ou des métaphores issues des grandes valeurs collectives d’une culture. Par exemple, la femme soignante, l’homme décideur, etc.
Pour Pierre Moscovici, reprenant et développant les travaux d’Emile Durkheim, les représentations sociales permettent l’institution d’une réalité consensuelle, l’intégration de la nouveauté, l’orientation des communications et des conduites. Il leur attribue quatre fonctions :
- La fonction de savoir qui permet de comprendre et d’expliquer la réalité
- La fonction identitaire, qui place l’individu dans le contexte et permet l’élaboration d’une identité sociale en adéquation avec les normes et valeurs
- La fonction d’orientation où il considère que les représentations prescrivent les comportements et conduites attendus par le groupe social (fonction d’auto-régulation du groupe)
- La fonction de justification permet à l’individu de légitimer ses décisions, actions et conduites à l’égard de ses pairs, mais aussi d’autres groupes sociaux.
Cette définition nous permet de comprendre que les représentations sociales jouent un rôle fondamental dans la manière que nous avons de percevoir et d’agir dans un contexte social, donc a fortiori dans celui d’une organisation.
Cependant, agir sur les représentations sociales, donc au niveau du système, me paraît difficile depuis un niveau individuel et répond plus au résultat d’un travail collectif, politique, visionnaire. Concentrons-nous alors sur la notion de rôles sociaux qui correspond à un potentiel d’action plus élevé, car individuel.
Bien que cette notion fasse l’objet de plusieurs approches (psychologie sociale, anthropologie, sociologie), un rôle social est généralement défini par l’ensemble des comportements attendus et mis en œuvre par un individu en fonction de sa position ou de son statut social.
Lorsque ce rôle est validé par la majorité des membres de la société, les personnes sont prêtes à fournir des efforts pour y correspondre ou à sanctionner celles ou ceux qui transgressent les normes sociales qui y sont attachées. Et c’est bien là que la notion de management au féminin trouve son origine car elle est corrélée directement aux représentations de la femme dans la société.
Les implicites dans le rôle social
Parmi les comportements attendus, manifestations concrètes du rôle, les attendus et les demandes prennent une place particulière. Ils sont, en effet, une source de vide ou de malentendus qui nourrissent les représentations fallacieuses. Si les attentes ne sont pas explicitées, la place laissée à l’interprétation est gigantesque car composée de mille non-dits qui font le lit de nombreux décalages entre ce que je veux sans le dire et ce que la personne fait.
Faire une demande, c’est prendre un risque et une responsabilité : le risque qu’on nous dise non, la responsabilité d’avoir le courage de prendre ce risque. Tout dépendra alors de notre capacité à faire face aux conséquences d’un non. Le courage de faire face n’est pas non plus genré, il dépend plutôt d’une certaine maturité émotionnelle et managériale.
Le rôle de la femme évolue
Historiquement, la société occidentale s’est construite autour de la notion de patriarcat : le masculin décide, gère, manage, et le féminin exécute, soigne, participe au renouvellement de la population et à sa protection sous la tutelle du masculin. Bien que très limitante pour le féminin puisqu’aucun des constituants d’une personne n’est genré, ce modèle a été de tout temps considéré comme le modèle dominant.
La marche de l’histoire en Occident et dans de nombreux pays ont permis des améliorations en matière de répartition des rôles depuis la première guerre mondiale notamment, même si les dernières décennies et les crises successives récentes amènent une dégradation de l’égalité homme / femme à travers le monde (voir par exemple la situation aux USA en ce qui concerne le droit à l’avortement).
Il est cependant un domaine qui change moins vite que la réalité quotidienne, c’est celui des représentations et des rôles, car il dépend non seulement des individus mais aussi des normes sociales. Comme une culture d’entreprise, la culture d’une société est longue à faire évoluer puisqu’elle nécessite que la majorité de ses membres adhérent au changement proposé.
Nous sentons cependant toutes et tous que la place de la femme dans la société ne correspond plus du tout à ce qui en est attendu par le plus grand nombre : le temps est-il venu ?

D’où venons-nous ? Le rôle archaïque et non valorisé de la femme
De tous temps, les femmes ont géré quantité de rôles sociaux, avec l’attendu du « prendre soin de l’autre » en filigrane. Fille, mère, ménagère, éducatrice, amante, soignante, les fonctions sociales de la femme ont longtemps été définies uniquement par des qualificatifs.
On ne parlait ni de métier ni de fonction pour les femmes, même quand elles travaillaient. Elles étaient souvent qualifiées de « femme de… » ou « fille de… » parce que seul le métier de leur mari ou de leur père était reconnu valable, même si la quantité ou la valeur des tâches effectuées était énorme. Pire, la veuve prenait l’entier du patronyme de son mari décédé – un tragique exemple d’aliénation.
De plus, la fonction du « prendre soin » n’a été quantifiée que très récemment et de façon quasiment marginale, non reconnue socialement parce que non reconnue économiquement. On se souvient des levers de boucliers de toute part lorsque des chiffres correspondant à des équivalents de rémunération ont été articulés.
Ainsi, la société dans son ensemble peine encore à considérer la femme comme un individu capable. La femme reste l’adjuvant d’un membre masculin qu’elle soutient.
Je pense que la faiblesse de la notion de management au féminin découle directement de ce constat.
Le management au féminin n’existe pas
Même manager, la femme est encore soumise à ces rôles et représentations. On attend d’elle qu’elle ait les compétences requises (voire plus) mais aussi les qualités du « prendre soin », comme si son rôle de mère (réel ou fantasmé) faisait partie de ses tâches opérationnelles : toutes les femmes manager doivent materner.
Plus encore, cette attente vient non seulement des personnes mais aussi du système. Nos amis québécois ont défini le concept du mamangement pour parler de ces attentes. Ce concept, dérivé de celui de gouvernemaman (qui développe l’idée que le gouvernement infantilise les citoyens en prenant trop soin de ses administrés) reprend l’idée que la femme devrait pourvoir à tous les besoins de base de l’organisation.
Il est ainsi difficile de trouver les contours d’un cahier des charges raisonnable dans cette définition. En effet, la société définit encore trop les rôles sociaux sur des attentes genrées (force et courage pour les hommes, gentillesse et douceur pour les femmes). Les femmes qui managent “comme des hommes” sont catégorisées hors norme (bossy, ou pire, bitchy), sortant du rôle assigné à leur sexe (management en douceur) ou présentant le reflet déformé de leur personnalité.
Mais le bât commence vraiment à blesser et les différents genres revendiquent bien naturellement que les représentations changent. Il est temps.
Et si nous profitions de cette occasion unique pour agir individuellement et ainsi participer à l’évolution de la société ?
Plutôt que de créer une case à part, celle du management au féminin, reliée au genre et à ses représentations, qui enferme une fois de plus les femmes (et les hommes !) dans un rôle qui les dessert et empêche la performance organisationnelle, pourquoi ne pas offrir à chacun.e des pistes pour définir son rôle de manager indépendamment du sexe ?
Nous tenterons des pistes de réponse dans un prochain article !