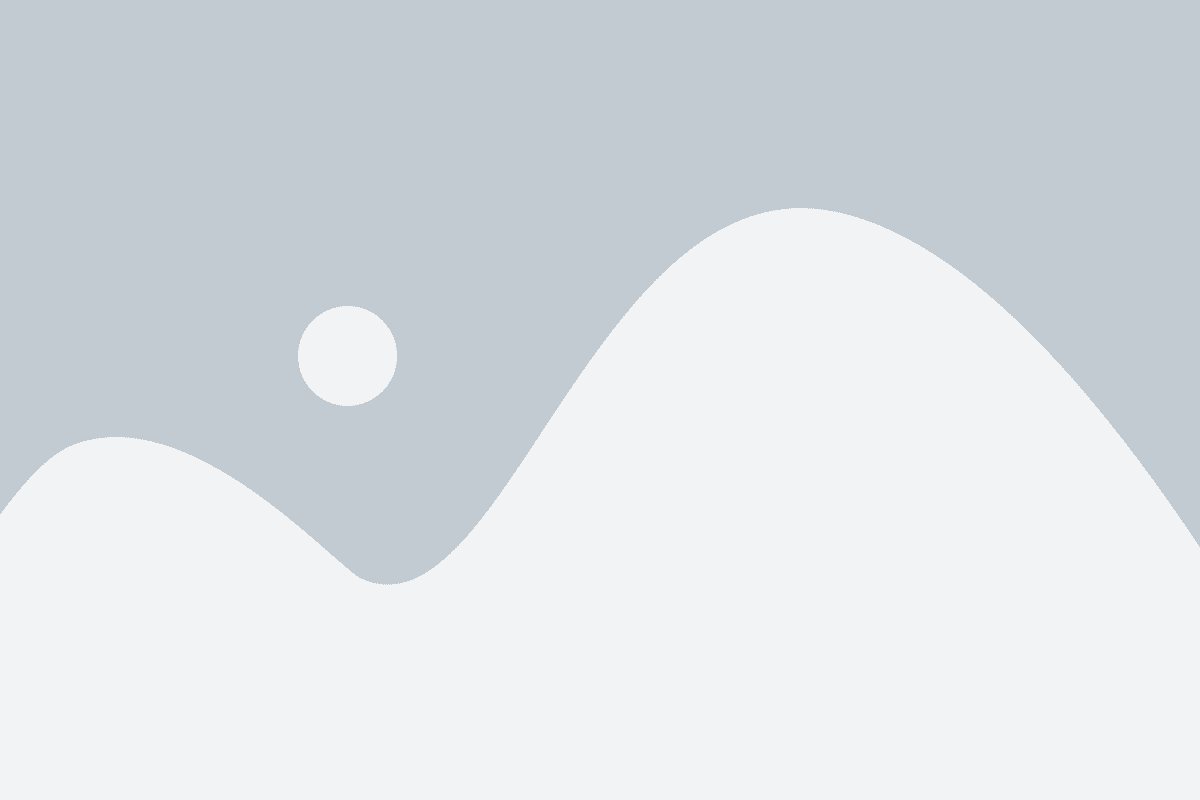Pourquoi la philo?
Fin mars 2023, j’ai eu la chance de pouvoir aller écouter Julia de Funès lors d’une conférence au salon RH de Zürich.
Clarté et démonstration limpides, dans le style Julia de Funès qui commence à être (re)connu, qui s’appuie sur des concepts philosophique à propos du bonheur au travail et qui pose la question : en quoi la philosophie peut-elle éclairer la difficulté à vivre en entreprise et la crise de sens au travail qui fait tant de ravages aujourd’hui ?
Ce que disent les philosophes tient en quelques mots : si les personnes sont réduites à n’être que des outils au service des processus, cela crée des crises chez celles-ci, et donc une crise globale potentielle chez tout employeur, petit ou grand.
Cette crise globale, nous la traversons actuellement dans nos organisations : Quiet quitting, augmentation des burn out, difficulté à fidéliser les employés, etc. Tous ces indicateurs doivent nous rendre attentifs et nous pousser à la réflexion.
Comme l’étymologie du mot crise (du grec Krisé, danger mais aussi opportunité) nous le dit, nous pouvons en avoir deux visions possibles: la vivre comme une contrainte ou comme une chance.
Dans sa conférence, Julia de Funès décline les deux possibilités en termes de process négatif et process positif.

Le process négatif, ou la crise de sens au travail vue comme une contrainte
Le process négatif est décliné en trois aspects: la peur, le bonheur universel et le tout collectif.
La peur
La peur altère la réalité. Or nous vivons dans une société où la peur est valorisée par le principe de précaution (dont le vocabulaire fait partie de l’heuristique de la peur, en référence à Hans Jonas dont la théorie affirmait que pour sauver le monde, il faut lui faire peur). Imaginer le pire pour réfléchir à partir de celui-ci. Cette vision altère la capacité à faire face et à agir. Pour les organisations, cela se résume à la paralysie de l’évolution : si on ne prend pas de risque, on n’agit pas.
Pour les individus, cela se décline également comme suit selon la philosophe d’entreprise : des règles pour tout, un accent fort sur les normes, le comportement normé et automatisé, sans que le sens général poursuivi par l’entreprise soit décliné auprès des collaborateurs. Cela tend à l’absurdité comme elle était déjà déclinée par Chaplin dans Les temps modernes en 1936. La peur aliène et fige l’action et le principe de précaution en est le bras armé. Tant que le processus primera sur le sens, la crise restera un danger.
Le bonheur universel
Une autre injonction qui entretient ce process négatif est parallèlement développée: le bonheur comme valeur universelle.
Le bien-être et le bonheur universels sont aussi un danger puisque, par définition, ce sont des valeurs subjectives. Ma notion des deux diffère de celle de mon voisin: ce qui me rend heureux ne rend pas heureux tout le monde.
Uniformiser le bien, c’est enjoindre aux individus une seule manière d’être heureux, réduire le bonheur à des cases à cocher et donc le rendre malfaisant, réduit au bonheurisme (selon la théorie de Vincent Cispedes dans Magique étude du bonheur). En effet, l’injonction, par son côté obligatoire, crée du malaise voire du mal-être. Son effet est paradoxal.
Selon Julia de Funès, « réduire le bonheur à un résultat de performance est une erreur car le bonheur n’est pas une condition de performance mais le résultat de celle-ci ». Donc partir du principe que les collaborateurs sont performants parce qu’ils sont heureux est, selon elle, erroné. Ils sont heureux au travail quand ils sont performants et l’immobilisme créé par la vision du pire empêche qu’ils le soient car leur créativité est une prise de risque trop dangereuse.
Dans cette vision, le management est devenu un processus de reconnaissance, pas un processus de leadership. La nomination des collaborateurs performants (donc appliquant parfaitement les processus) n’équipe pas les managers en compétences managériales. Ni en charisme, d’ailleurs, que Julia de Funès définit comme la capacité à habiter son message, le courage d’être soi-même. Le management ne devrait plus être considéré comme une promotion dans la vision de Julia de Funès, mais comme un moyen d’être soi.
Le tout collectif
Ce qui nous conduit sur le troisième aspect du process négatif : le tout collectif.
Tout n’est pas collectif dans les organisations. Pour que la notion de collectif fonctionne, il y a trois conditions indispensables :
- Du travail individuel en amont
- Une stratégie et une direction indispensables mais complétées par la solidarité entre les membres de l’organisation
- Chaque membre est en mesure de prendre un risque pour lui-même (par exemple si l’erreur a une valeur d’expérience positive et pas de risque qu’on ne peut pas prendre)
Elle termine en disant que l’esprit d’équipe ne peut exister et fonctionner que si les enjeux et les opportunités sont clairement définis et transmis. Le flou génère l’immobilisme.

La logique positive ou la crise de sens au travail vue comme une opportunité
Pour Julia de Funès, pour transformer la crise en opportunité, les collaborateurs doivent se sentir acteurs dans leurs vies professionnelles, authentiques. D’ailleurs, action, acteur et authentique ont la même étymologie.
Pour y parvenir, cela nécessite de pouvoir revenir à soi, de trois manières.
Etre un sujet
On n’est pas un sujet si on ne prend pas de risque.
Les collaborateurs doivent pouvoir le faire, jouer avec les aléas, quand l’organisation promeut qu’il y a moins à perdre à prendre un risque qu’à rester immobile. Elle favorise l’intelligence d’action et l’intuition plutôt que l’immobilisme.
Ce changement de paradigme n’est pas égal à accepter le passage à l’acte ou le raptus d’action. Une prise de risque se calcule et se construit, comme toutes les actions.
Trouver du sens
Le collaborateur doit pouvoir répondre à la question « pourquoi est-ce que je fais ça ? » plutôt qu’à la question « comment je fais cela ? ». Le sens, la finalité doivent reprendre la main sur la technique, replaçant celle-ci à sa place de moyen d’action.
Répondre à la question « à quoi je sers ? » est primordiale pour l’être humain. Elle remet aussi la valeur Travail à sa place de moyen d’exister au lieu de finalité de l’existence.
En désacralisant le travail, on lui rend du sens. Il n’est plus le but ultime. Pour Julia de Funès, pour que le travail fasse sens, il faut que la raison d’être de l’entreprise transcende ses process, qu’il y ai une notion de mission à accomplir, une mission authentique , donc courageuse, dans laquelle le collaborateur peut se projeter. Et dans laquelle il se sent réhaussé, mis en valeur.
Confiance en soi
Cette logique positive implique aussi que l’organisation doit favoriser la confiance en soi et dans les autres (confiance vient du latin cumfidere, avec foi).
Avoir foi en quelque chose, c’est comme faire un pari sur l’inconnu. La confiance n’est pas du registre du cognitif, de la connaissance, du processus. Selon Julia de Funès, la confiance est l’inverse du contrôle. Elle est responsabilisante. Elle est rentable pour l’entreprise. Elle permet à l’individu de se sentir un sujet et plus seulement une pièce d’un process.
Conclusion: prise de risque, sens et confiance
Pour Julia de Funès, prise de risque, sens et confiance sont des piliers humains. Ils sont de l’ordre de la réflexivité, de la compétence humaine de réfléchir à sa propre action.
Citant Alain, elle conclut : « ne décidant jamais, on dirige toujours ». Le sens n’est pas un mot vain, c’est ce qu’on met dedans qui permet qu’il s’anime. C’est une question de volonté et de lucidité des individus de mettre du sens dans les organisations.
Pour finir, le moyen de moins subir la vie en organisation se résumerait dans la phrase suivante, qui sonne presque somme un paradoxe assumé par son auteure : autonomiser les individus humanise les entreprises.